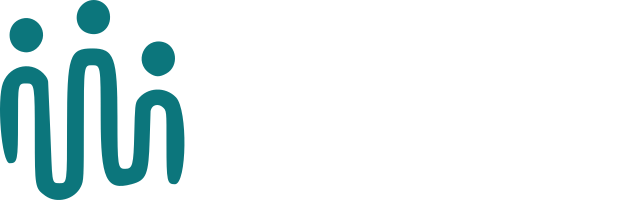L’autorité bienveillante existe-t-elle vraiment ?
L’autorité bienveillante fascine autant qu’elle divise. Derrière ce concept séduisant, les managers se heurtent à des dilemmes quotidiens : poser un cadre sans braquer, recadrer sans humilier, soutenir sans infantiliser. Loin des discours idéalisés, la réalité du terrain révèle la complexité d’une posture qui exige courage, finesse et lucidité. À travers des scènes vécues et des cas d’entreprise, cet article explore les ressorts, les tensions et les limites de l’autorité bienveillante.

Scène de terrain : la réunion qui dérape
Dans une PME industrielle, Sophie, responsable d’équipe, anime une réunion de lancement de projet. Dès les premiers échanges, un collaborateur, Thomas, conteste ouvertement le calendrier imposé. Le ton monte, la tension s’installe. Sophie choisit de ne pas esquiver le conflit. Elle reformule calmement les objections, rappelle les enjeux collectifs, puis propose une pause pour apaiser les esprits. Après la réunion, elle prend Thomas à part : « Je comprends tes inquiétudes, mais ce projet est prioritaire pour l’entreprise. Je compte sur toi pour trouver des solutions, pas pour bloquer le groupe. »
Ce recadrage, ferme mais respectueux, marque un tournant : Thomas s’implique davantage, et le reste de l’équipe perçoit que la bienveillance de Sophie n’exclut ni l’exigence ni la clarté.
Les paradoxes du quotidien
En réalité, l’autorité bienveillante place les managers face à des arbitrages délicats. Dire non sans démotiver suppose d’assumer une décision tout en ménageant le lien : dans une agence de communication, un directeur a ainsi refusé une demande de télétravail supplémentaire en expliquant avec transparence les contraintes liées à l’équipe. Il a proposé une contrepartie, sans masquer l’arbitrage.
Autre dilemme fréquent : recadrer sans humilier. Une responsable RH dans une maison d’édition a dû intervenir après un écart de comportement en réunion. Elle a choisi de convoquer la collaboratrice en entretien individuel, pour décrire les faits sans blesser ni juger. Soutenir sans infantiliser constitue enfin un équilibre subtil : dans une start-up en croissance, le CEO veille à stimuler l’autonomie de ses équipes tout en imposant des standards précis sur la qualité des livrables.
Toutes ces situations illustrent qu’il ne s’agit pas de « faire plaisir », mais de tenir un cap relationnel exigeant [1].
Quand le principe atteint ses limites
Ce modèle, aussi inspirant soit-il, rencontre rapidement ses propres limites. Dans une filiale bancaire sous tension commerciale, l’ambition de fonder les pratiques managériales sur l’écoute et la concertation s’est heurtée au mur des objectifs. Les managers, déstabilisés, ont vu apparaître des dérives : certains collaborateurs profitaient d’une tolérance excessive pour repousser les règles, tandis que d’autres, lassés par des décisions trop différées, remettaient en cause la légitimité de leur responsable.
Ce type de situation n’est pas isolé. Une enquête nationale de l’ANDRH menée en 2024 confirme que cette posture n’est viable que si l’organisation l’assume comme un modèle collectif et cohérent [2].
Ce que font les managers qui tiennent le cap
Dans les entreprises où cette posture devient réellement opérationnelle, certains leviers reviennent. Les recadrages sont préparés, jamais improvisés : le timing, le lieu, la formulation sont pensés pour préserver le lien. Le feedback est ritualisé, non pas vécu comme une urgence corrective, mais comme un espace d’ajustement régulier. Le collectif est associé à l’élaboration de règles partagées, ce qui renforce leur légitimité. Et surtout, les managers sont accompagnés : par leur propre hiérarchie, mais aussi par des espaces entre pairs, où les dilemmes peuvent être exposés sans crainte.
C’est ce qu’a mis en place Decathlon à travers son centre de formation, qui combine pédagogie managériale et apprentissage de la posture responsable [3]. Loin d’un simple affichage, ces dispositifs renforcent la consistance de la posture attendue
Un cadre exigeant mais structurant
Loin des slogans, l’autorité bienveillante s’éprouve dans les tensions du réel. Elle repose sur la capacité à poser des limites claires, à trancher sans abuser, à accueillir l’inconfort sans fuir. Elle ne protège ni du doute ni de l’échec, mais elle crée un cadre de sécurité psychologique, où l’exigence rime avec respect.
Certaines entreprises en font une boussole stratégique : elles investissent dans la formation, soutiennent les managers dans leurs arbitrages, reconnaissent les efforts relationnels au même titre que les résultats mesurables [4]. Ce soutien permet aux équipes de trouver un équilibre stable entre performance et climat de confiance. Comme le rappelle Yannick Lauber, l’autorité exercée avec justesse reste, encore aujourd’hui, une des conditions majeures de la cohésion et de la motivation durable [5].
Conclusion
L’autorité bienveillante n’est pas un mythe, mais une conquête quotidienne. Elle suppose de renoncer aux réflexes d’autorité rigide comme aux excès de la complaisance. C’est une posture qui se construit dans l’action, le doute et l’attention aux autres. Encore faut-il que les organisations aient le courage d’en faire une vraie ligne de conduite, pas un slogan.
À retenir
- L’autorité bienveillante s’éprouve dans les tensions concrètes du quotidien, pas dans les principes.
- Elle demande un vrai courage relationnel : dire non, poser un cadre, assumer les désaccords.
- Sans formation ni soutien, elle expose les managers à l’usure.
- Lorsqu’elle est portée collectivement, elle devient un levier de cohésion et d’engagement.
Sources & références
- ConvictionsRH (2024). Management bienveillant : n’en faisons-nous pas trop. Analyse des limites du management bienveillant. Lire l’article
- ANDRH (2024). Baromètre des pratiques managériales. Enquête nationale sur l’évolution des postures de management. Lire l’article
- Decathlon Recrutement (2024). Centre de formation Decathlon. Présentation des formations et engagements managériaux. Lire l’article
- Auriac, M. (2024). Entre bienveillance et autorité : tracer une voie du milieu en management. Réflexion sur l’équilibre entre bienveillance et autorité. Lire l’article
- Lauber, Y. (2021). Management : les vertus de l’autorité. Réflexion sur l’importance de l’autorité dans le management. Lire l’article